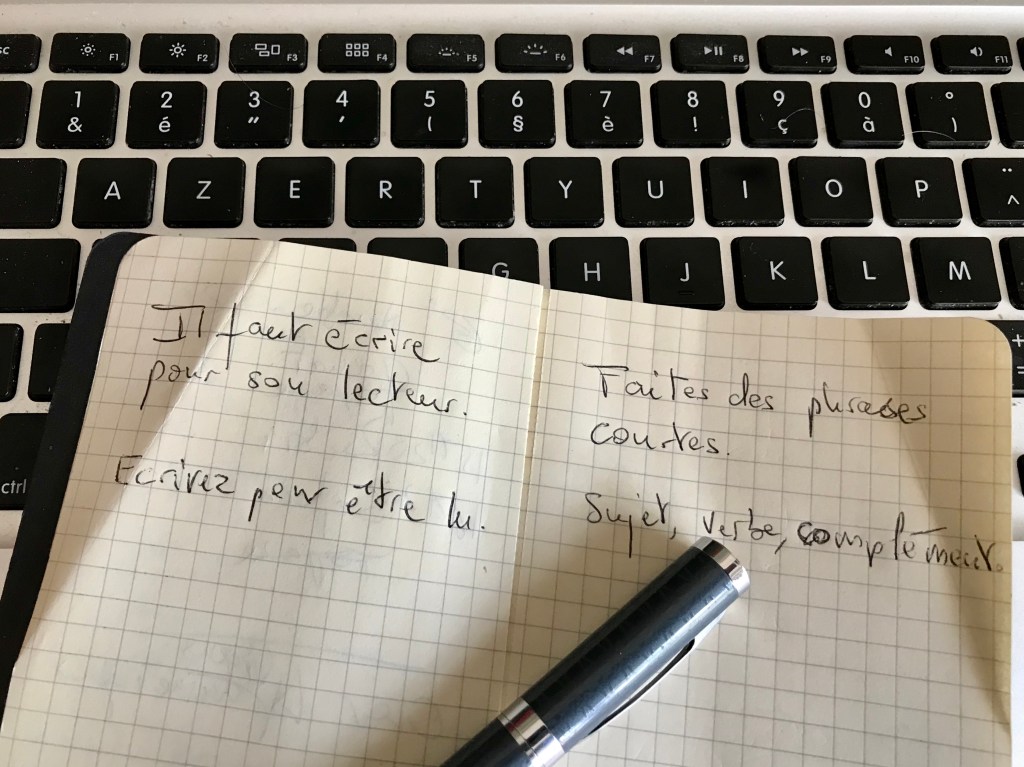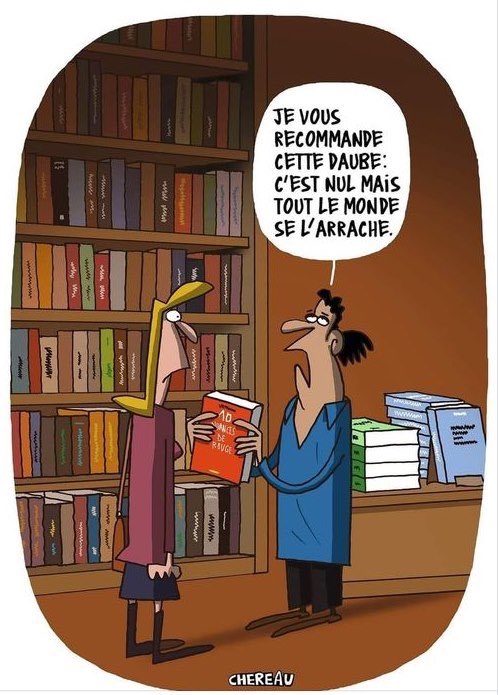La file s’étend sur quatre ou cinq kilomètres. Quatre ou cinq kilomètres de voitures, des Dacias pour la plupart, qui attendent docilement le droit de passer la frontière. Les moteurs sont arrêtés : l’essence coûte cher. Toutes les dix minutes environ la queue progresse de quelques mètres et chaque conducteur pousse péniblement son véhicule. Une légère brume m’empêche de distinguer le poste de douane, mais là où je suis je sais qu’il faudra encore patienter deux bonnes heures avant d’y arriver.
Bors. Point de passage entre la Roumanie et la Hongrie. Une vraie frontière, comme il n’en existe plus en Europe occidentale. Ici, ce n’est pas encore l’Orient mais ce n’est plus vraiment l’Occident. Rien n’est vraiment clair. Sommes-nous vraiment à la douane ? A t-on le droit de sortir de Roumanie ? Rien n’est moins sûr. L’ambiance est lourde. Les familles entassées dans les voitures font grise mine et attendent avec angoisse la rencontre avec le tout-puissant douanier, incontesté maître des lieux. Ici, il y a deux sortes de douaniers. Le genre gras et corrompu d’abord. Il promène son ventre et son uniforme gris sale autour de la voiture à la recherche du bakchich (ciubuc en roumain) qu’il est de toute façon certain d’encaisser. Une cartouche de cigarettes Kent. Quelques fruits, des chocolats pour ses enfants. Il ne se fait pas de souci le camarade douanier : tout est prévu. On trouve même des victimes consentantes au point d’apporter ostensiblement leur obole avant que le gros type leur ait demandé leurs passeports. Mêmes ceux qui n’ont rien à passer en fraude agissent ainsi. Chacun est tellement convaincu que le franchissement de la frontière se passera mal qu’il tente d’agir à titre préventif. Absurde. Et puis il y a le douanier-sans-peur-et-sans-reproche. Le chevalier Bayard de la frontière. Plutôt jeune, genre pète-sec et arrogant. Il prend son temps avec les passeports de tous les occupants du véhicule et il réclame bien sûr les papiers de la voiture. “Papiers de la voiture !” grogne t-il généralement. “Pardon ?” répondent parfois les inconscients, habitués à un peu plus de politesse. L’autre beugle alors pour de bon :“Papiers de la voiture !”. Chef, oui chef ! Tout de suite, chef !
De temps en temps, la frontière ferme. C’est l’heure de la relève des douaniers, et l’opération peut durer trente minutes, une heure… On ne sait pas. On ne sait jamais de toute façon. Pour les malheureux qui ont fait la queue pendant deux ou trois heures et qui arrivent devant la barrière juste à ce moment-là, c’est un peu dur. Certains s’énervent, mais cela ne sert à rien.
Ma voiture est dotée d’une plaque diplomatique. Aussi je commence à remonter tranquillement la file afin de me présenter à la guérite prévue pour les diplomates et autres privilégiés. Mais je renonce rapidement devant le regard assassin de certains conducteurs. L’un d’entre eux menace même de casser mon pare-brise si je passe devant tout le monde. Alors je rentre dans le rang et, comme les autres, je me fonds dans la masse. En silence mais en pestant intérieurement contre l’imbécillité bureaucratique et les ravages infligés par elle au genre humain.
Une fois la douane roumaine franchie, chacun respire un grand coup avant l’épreuve suivante. À cinq cents mètres à peine, une autre barrière, d’autres guérites. C’est la douane hongroise.
Bucarest, le 3 mai 1991
(Extrait de Jours tranquilles à l’Est, paru en 2013 aux éditions Riveneuve)